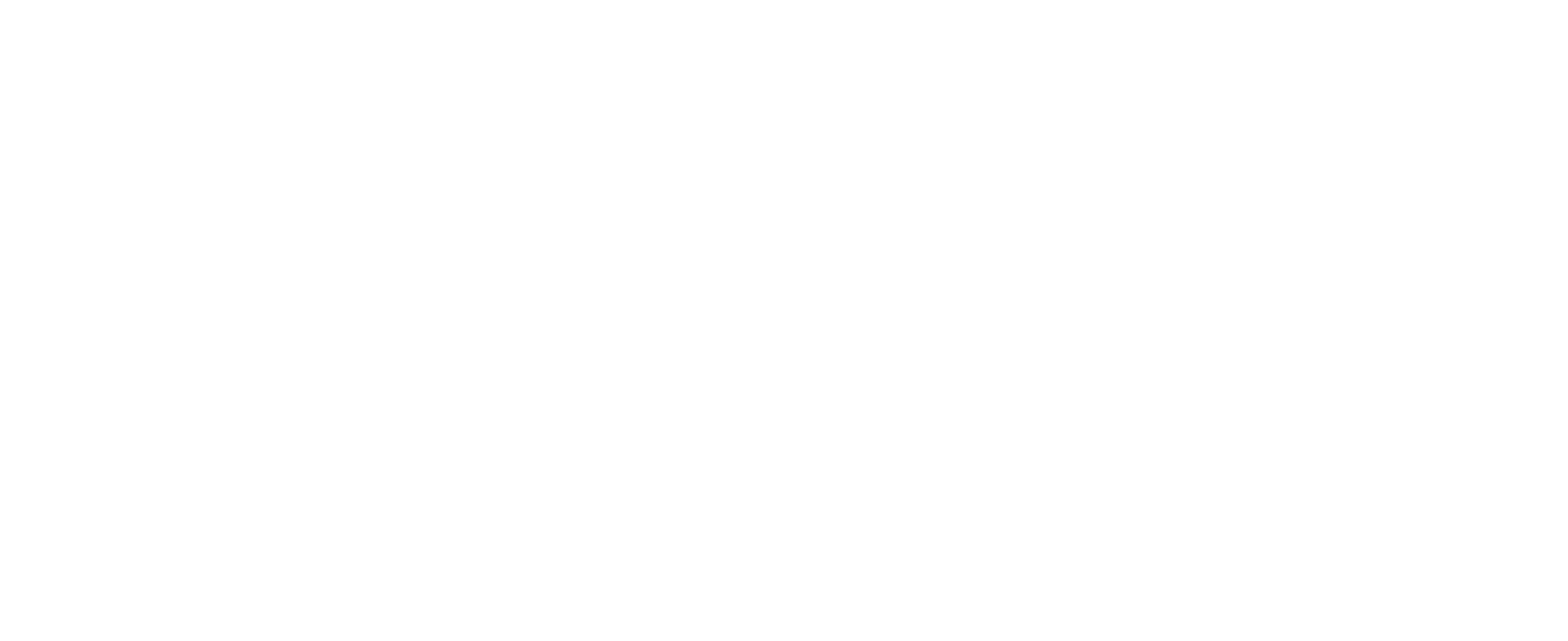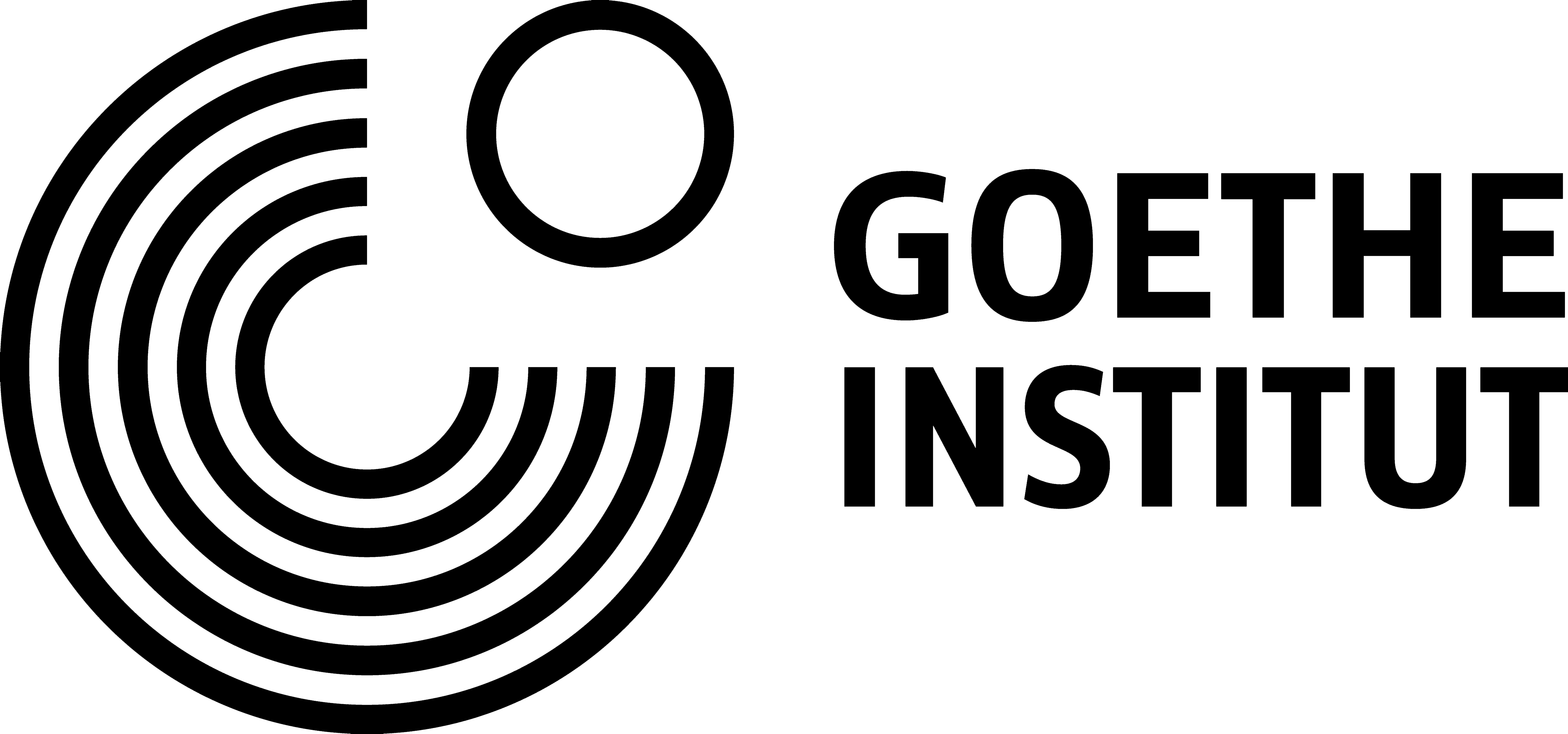Revivre le sacré
s'engager avec des traditions indigènes comme Wayyuu pour un
avenir féministe
Fayo Said
Temps approximatif de lecture : 8 minutes
Avertissement : Mentions de violences sexuelles
Je n'ai pas grandi en connaissant le concept de wayyuu. Cela ne faisait pas partie des histoires partagées autour d'un buna (café) ni reflétée dans les traditions pratiquées chez nous. En tant que femme oromo élevée dans la diaspora, mon lien avec l'héritage est venu à travers la langue, la musique et les luttes politiques que mes parents partageaient avec nous. Ils ont rempli notre maison d'objets traditionnels et de rassemblements communautaires, donnant à notre culture un sentiment de présence et de vie. Mais les rituels qui plaçaient la dignité des femmes au centre manquaient. Façonnées par la migration et le temps, des pratiques comme le sinqee1 et l'ateete2 avaient disparu de la vie quotidienne.
J'ai découvert ces traditions menées par des femmes dans des livres et des essais que j'ai trouvés dans la bibliothèque de mon université. C'est là que j'ai appris du sinqee, un long bâton symbolisant l'autorité d'une femme mariée, et de l'ateete, une prière collective et une protestation menée par des femmes. Je me souviens avoir lu à leur sujet avec un mélange de fascination et de confusion. Comment des pratiques aussi marquantes ont-elles pu passer inaperçues dans ma propre vie ? J'ai commencé à poser des questions, et ma mère et mes tantes ont partagé ce dont elles se souvenaient. Leurs souvenirs m'ont aidé à reconstituer un tableau de traditions qui, bien qu'elles ne soient plus (largement) pratiquées, vivent encore de manière discrète.
Au cœur de ces traditions se trouve le wayyuu, « un concept moral de respect et de sacralité »3, qui guidait la manière dont les Oromo se rapportent entre eux, au monde naturel et à Dieu (Waaqa). Certaines personnes, actions et objets sont considérés comme wayyuu, ce qui signifie qu'ils sont sacrés ou intouchables. La terre est wayyuu. Les beaux-parents sont wayyuu. Une femme mariée, c'est wayyuu. Bien que de nombreuses choses et personnes puissent avoir ce statut, le concept est souvent étroitement lié aux femmes et aux espaces qui leur sont associés.4 Être considéré comme wayyuu, c'est être protégé du danger et traité avec soin. Non seulement elle façonne le comportement social, mais elle est aussi à la base des cadres par lesquels des pratiques comme le sinqee et l'ateete prennent du sens.
Apprendre des traditions comme le sinqee et l'ateete a ouvert des questions non seulement sur le passé, mais aussi sur les types de justice que nous imaginons aujourd'hui. Plutôt que de traiter ces pratiques comme des résidus culturels, je me demande ce qui est possible lorsqu'on les aborde comme des philosophies vivantes. Colonialismeturbées par le Colonialisme et remodelées par la religion, ces traditions conservent des idées radicalement différentes des cadres féministes occidentaux. En les revisitant, j'espère contribuer à la conversation croissante sur la manière dont le savoir autochtone peut contribuer à façonner un avenir plus juste pour les femmes.
Sinqee et Ateete : Institutions de protestation et de protection des femmes
Les concepts que j'explore proviennent des Oromo, le plus grand groupe ethnique d'Éthiopie et le plus peuplé de la Corne de l'Afrique. Au cœur de leur ordre social se trouvait le système gadaa, une gouvernance démocratique indigène fondée sur un leadership tournant, des tranches d'âge et une prise de décision collective. Avant l'expansion de l'Empire éthiopien à la fin du XIXe siècle, la gadaa défendait l'équité entre les clans, protégeait les droits et privilégiait le dialogue dans la résolution des conflits.
Bien que les femmes n'occupaient aucune fonction politique formelle au sein de la gadaa, leur autorité était institutionnalisée par des systèmes parallèles tels que le sinqee et l'ateete, ce qui leur permettait de répondre à l'injustice et de faire entendre leur voix. Ainsi, gadaa a intégré les valeurs de wayyuu dans la vie quotidienne.5
Le sinqee, également appelé ulee sinqee, est un long bâton en bois que donné à une femme le jour de son mariage par sa mère. Souvent décrit comme l'arme d'une femme, il symbolisait le respect qu'une femme mariée porte dans sa communauté. Elle affirmait son droit d'être entendue et de vivre avec dignité. Une femme portant son sinqee ne devait pas être confrontée et tout mal porté à son encontre était considéré comme inacceptable. Les mariages pouvaient ou non être officialisés par une cérémonie de sinqee.6 Lorsque cela se produisait, on disait que la femme était « mariée par sinqee » (sinqee gurguraan), ce qui lui conférait pleine reconnaissance et droits dans la maison de son mari.7 Sans ce rite, elle aurait pu être traitée avec moins de respect et bénéficier d'une position plus faible au sein de la structure familiale.
Le sinqee a été utilisé dans de nombreux contextes différents. Il apparaissait dans les cérémonies religieuses traditionnelles8, en particulier lorsque les femmes se rassemblaient pour exécuter le ateete. Lors de ces rassemblements, les femmes marchaient ensemble jusqu'aux rives pour prier Dieu en réponse aux difficultés communautaires telles que la sécheresse, l'infertilité, la maladie ou les conflits. Le sinqee était également utilisé lorsque les femmes subissaient des blessures personnelles. Si une femme était battue, insultée ou violée sexuellement, elle portait son bâton en public pour protester contre l'injustice. Le sinqee était également utilisé lors des cérémonies de mariage et lors de conflits (inter-)clans.
Clairement, le sinqee était plus qu'un objet. Elle faisait partie d'une institution plus large dirigée par des femmes, avec des rôles sociaux, politiques et spirituels. Dans certaines régions, sinqee était utilisé pour décrire ces actions collectives, tandis que dans d'autres, le terme ateete était plus courant. Les deux sont souvent utilisés de manière interchangeable, désignant tous deux des rassemblements où les femmes ont réagi à des préjudices et des violations de leurs droits.9
Dans le passé, pour appeler à l'ateete en cas de mauvais traitements, une femme commençait par ululer (elelele) pour signaler à l'aide. Entendant l'appel, d'autres femmes attrapent leur sinqee et se précipitent pour la rejoindre. Alors qu'ils se rassemblent, ils continuent le même son, créant un avertissement collectif. Une fois réunies, les femmes s'assoient ou se tiennent en cercle et chantent le mal causé, nommant la violation et affirmant le droit de la femme à être traitée avec dignité. Dans un cas, des femmes ont pratiqué des ateete après qu'un homme ait utilisé le mot koonka10 (vieux contenants de lait vides), une insulte profondément offensante envers une femme.11 Le rituel se poursuivrait jusqu'à ce que l'homme admette son tort et demande pardon. Dans de nombreux cas, le processus se termine par un acte symbolique de réconciliation, comme l'abattage d'une vache ou d'un mouton pour rétablir l'équilibre social.12
Des institutions similaires ont été documentées dans d'autres communautés d'Afrique de l'Est, telles que les Iraqw en Tanzanie et les Sidama qui pratiquent le yakka en Éthiopie.13 Ces parallèles mettent en lumière l'importance culturelle plus large de l'action politique menée par les femmes dans toute la région.
Quand une femme parle, on y croit
Dans la société oromo traditionnelle, les questions de préjudice sexuel étaient abordées par le droit coutumier fondé sur la confiance dans la voix des femmes. Un proverbe le résume clairement14 :
Qiriin15 obolessa kute
Yoo isiin toola gote, tola
Yoo isiin gora gote, gora.
L'homme dénoua ses vêtements
Si elle dit que c'est correct, c'est normal
Si elle dit que c'est Gora, c'est Gora.
En ce qui concerne les actes sexuels, c'était la femme qui déterminait si un préjudice avait eu lieu ? Sa parole était entièrement fiable. Si elle l'a nommé gora16, alors il a été accepté comme tel, sans avoir besoin de témoins ni de preuves supplémentaires. Ce principe reflétait la conviction que les femmes ne mentent pas sur de telles questions, en raison de leur statut wayyuu. Comme l'ont dit les anciens, « une femme ne ment pas » (dubartiin hin sobdu), et son récit avait un poids légal et moral.17 Même dans les cas où un homme niait toute faute, ses propres proches étaient censés le pousser à admettre sa faute, à éviter un procès sous serment, ce qui comportait le risque d'une punition spirituelle pour tout le clan. Cette confiance reposait sur des idées d'honnêteté et dans la croyance que les femmes étaient plus humbles et plus proches de Dieu.18 Bien que ces systèmes coutumiers se soient affaiblis avec le temps, ils offrent un contraste frappant avec les silences et l'incrédulité qui entourent souvent la violence sexuelle aujourd'hui. Dans de nombreux espaces contemporains, les survivants peinent encore à être crus, faisant de ces anciens cadres une ressource puissante pour imaginer des formes alternatives de justice.
Tradition, religion et le rôle changeant des femmes
L'arrivée du christianisme et de l'islam a apporté des changements significatifs à la manière dont de nombreuses communautés oromo s'engageaient avec des pratiques telles que le sinqee et l'ateete. Bien que ces traditions aient été autrefois reconnues comme des interventions importantes, elles ont progressivement été mises sous la pression des autorités religieuses. Dans certaines régions, l'ateete a été décrit comme un « vestige païen » ou qualifié d'anti-chrétien/islamique, et les femmes qui se rassemblent pour le faire peuvent être perçues comme dépassant les frontières religieuses.19 Parce que ces pratiques se sont développées à une époque où les Oromo suivaient en grande partie les waqaaffennaa, leur système de croyances traditionnel, ils sont souvent considérés comme indissociables de celui-ci. Cela a conduit que certains hésitent à les pratiquer, par crainte que cela ne contredise les nouveaux cadres religieux.
Ces tensions ne concernent pas seulement la croyance, mais la manière dont les religions institutionnalisées ont remodelé les anciennes façons d'organiser la vie sociale. Bien que le système gadaa ait décliné, l'autorité des hommes est restée en grande partie intacte, tandis que la capacité des femmes à s'exprimer et à intervenir en cas de crise via des institutions comme l'ateete et le sinqee s'est de plus en plus limitée.
Bien que ces traditions ne soient plus largement pratiquées, elles n'ont pas totalement disparu. Sur des plateformes comme YouTube, on peut voir des femmes oromo revivre des éléments de sinqee et de ateete à travers des présentations culturelles et des performances.20 Bien que ces derniers ne portent peut-être pas la même autorité qu'auparavant, ils reflètent un effort continu pour honorer et protéger ce qui reste.
Cela résonne profondément en moi. Même si les traditions changent ou perdent leur forme d'origine, elles gardent toujours un sens. Ces pratiques n'étaient pas parfaites, car toutes les femmes n'y avaient pas un accès égal ; Sinqee et Ateete centraient les femmes mariées, soulevant des questions sur la manière dont les femmes non mariées étaient valorisées et sur la manière dont ces systèmes renforçaient les structures patriarcales. Pourtant, elles offrent un point de départ différent, nous montrant que d'autres façons de prendre soin et de résister ont existé, et que s'en souvenir est en soi un acte de maintien de ces possibilités vivantes.
J'ai découvert ces traditions menées par des femmes dans des livres et des essais que j'ai trouvés dans la bibliothèque de mon université. C'est là que j'ai appris du sinqee, un long bâton symbolisant l'autorité d'une femme mariée, et de l'ateete, une prière collective et une protestation menée par des femmes. Je me souviens avoir lu à leur sujet avec un mélange de fascination et de confusion. Comment des pratiques aussi marquantes ont-elles pu passer inaperçues dans ma propre vie ? J'ai commencé à poser des questions, et ma mère et mes tantes ont partagé ce dont elles se souvenaient. Leurs souvenirs m'ont aidé à reconstituer un tableau de traditions qui, bien qu'elles ne soient plus (largement) pratiquées, vivent encore de manière discrète.
Au cœur de ces traditions se trouve le wayyuu, « un concept moral de respect et de sacralité »3, qui guidait la manière dont les Oromo se rapportent entre eux, au monde naturel et à Dieu (Waaqa). Certaines personnes, actions et objets sont considérés comme wayyuu, ce qui signifie qu'ils sont sacrés ou intouchables. La terre est wayyuu. Les beaux-parents sont wayyuu. Une femme mariée, c'est wayyuu. Bien que de nombreuses choses et personnes puissent avoir ce statut, le concept est souvent étroitement lié aux femmes et aux espaces qui leur sont associés.4 Être considéré comme wayyuu, c'est être protégé du danger et traité avec soin. Non seulement elle façonne le comportement social, mais elle est aussi à la base des cadres par lesquels des pratiques comme le sinqee et l'ateete prennent du sens.
Apprendre des traditions comme le sinqee et l'ateete a ouvert des questions non seulement sur le passé, mais aussi sur les types de justice que nous imaginons aujourd'hui. Plutôt que de traiter ces pratiques comme des résidus culturels, je me demande ce qui est possible lorsqu'on les aborde comme des philosophies vivantes. Colonialismeturbées par le Colonialisme et remodelées par la religion, ces traditions conservent des idées radicalement différentes des cadres féministes occidentaux. En les revisitant, j'espère contribuer à la conversation croissante sur la manière dont le savoir autochtone peut contribuer à façonner un avenir plus juste pour les femmes.
Sinqee et Ateete : Institutions de protestation et de protection des femmes
Les concepts que j'explore proviennent des Oromo, le plus grand groupe ethnique d'Éthiopie et le plus peuplé de la Corne de l'Afrique. Au cœur de leur ordre social se trouvait le système gadaa, une gouvernance démocratique indigène fondée sur un leadership tournant, des tranches d'âge et une prise de décision collective. Avant l'expansion de l'Empire éthiopien à la fin du XIXe siècle, la gadaa défendait l'équité entre les clans, protégeait les droits et privilégiait le dialogue dans la résolution des conflits.
Bien que les femmes n'occupaient aucune fonction politique formelle au sein de la gadaa, leur autorité était institutionnalisée par des systèmes parallèles tels que le sinqee et l'ateete, ce qui leur permettait de répondre à l'injustice et de faire entendre leur voix. Ainsi, gadaa a intégré les valeurs de wayyuu dans la vie quotidienne.5
Le sinqee, également appelé ulee sinqee, est un long bâton en bois que donné à une femme le jour de son mariage par sa mère. Souvent décrit comme l'arme d'une femme, il symbolisait le respect qu'une femme mariée porte dans sa communauté. Elle affirmait son droit d'être entendue et de vivre avec dignité. Une femme portant son sinqee ne devait pas être confrontée et tout mal porté à son encontre était considéré comme inacceptable. Les mariages pouvaient ou non être officialisés par une cérémonie de sinqee.6 Lorsque cela se produisait, on disait que la femme était « mariée par sinqee » (sinqee gurguraan), ce qui lui conférait pleine reconnaissance et droits dans la maison de son mari.7 Sans ce rite, elle aurait pu être traitée avec moins de respect et bénéficier d'une position plus faible au sein de la structure familiale.
Le sinqee a été utilisé dans de nombreux contextes différents. Il apparaissait dans les cérémonies religieuses traditionnelles8, en particulier lorsque les femmes se rassemblaient pour exécuter le ateete. Lors de ces rassemblements, les femmes marchaient ensemble jusqu'aux rives pour prier Dieu en réponse aux difficultés communautaires telles que la sécheresse, l'infertilité, la maladie ou les conflits. Le sinqee était également utilisé lorsque les femmes subissaient des blessures personnelles. Si une femme était battue, insultée ou violée sexuellement, elle portait son bâton en public pour protester contre l'injustice. Le sinqee était également utilisé lors des cérémonies de mariage et lors de conflits (inter-)clans.
Clairement, le sinqee était plus qu'un objet. Elle faisait partie d'une institution plus large dirigée par des femmes, avec des rôles sociaux, politiques et spirituels. Dans certaines régions, sinqee était utilisé pour décrire ces actions collectives, tandis que dans d'autres, le terme ateete était plus courant. Les deux sont souvent utilisés de manière interchangeable, désignant tous deux des rassemblements où les femmes ont réagi à des préjudices et des violations de leurs droits.9
Dans le passé, pour appeler à l'ateete en cas de mauvais traitements, une femme commençait par ululer (elelele) pour signaler à l'aide. Entendant l'appel, d'autres femmes attrapent leur sinqee et se précipitent pour la rejoindre. Alors qu'ils se rassemblent, ils continuent le même son, créant un avertissement collectif. Une fois réunies, les femmes s'assoient ou se tiennent en cercle et chantent le mal causé, nommant la violation et affirmant le droit de la femme à être traitée avec dignité. Dans un cas, des femmes ont pratiqué des ateete après qu'un homme ait utilisé le mot koonka10 (vieux contenants de lait vides), une insulte profondément offensante envers une femme.11 Le rituel se poursuivrait jusqu'à ce que l'homme admette son tort et demande pardon. Dans de nombreux cas, le processus se termine par un acte symbolique de réconciliation, comme l'abattage d'une vache ou d'un mouton pour rétablir l'équilibre social.12
Des institutions similaires ont été documentées dans d'autres communautés d'Afrique de l'Est, telles que les Iraqw en Tanzanie et les Sidama qui pratiquent le yakka en Éthiopie.13 Ces parallèles mettent en lumière l'importance culturelle plus large de l'action politique menée par les femmes dans toute la région.
Quand une femme parle, on y croit
Dans la société oromo traditionnelle, les questions de préjudice sexuel étaient abordées par le droit coutumier fondé sur la confiance dans la voix des femmes. Un proverbe le résume clairement14 :
Qiriin15 obolessa kute
Yoo isiin toola gote, tola
Yoo isiin gora gote, gora.
L'homme dénoua ses vêtements
Si elle dit que c'est correct, c'est normal
Si elle dit que c'est Gora, c'est Gora.
En ce qui concerne les actes sexuels, c'était la femme qui déterminait si un préjudice avait eu lieu ? Sa parole était entièrement fiable. Si elle l'a nommé gora16, alors il a été accepté comme tel, sans avoir besoin de témoins ni de preuves supplémentaires. Ce principe reflétait la conviction que les femmes ne mentent pas sur de telles questions, en raison de leur statut wayyuu. Comme l'ont dit les anciens, « une femme ne ment pas » (dubartiin hin sobdu), et son récit avait un poids légal et moral.17 Même dans les cas où un homme niait toute faute, ses propres proches étaient censés le pousser à admettre sa faute, à éviter un procès sous serment, ce qui comportait le risque d'une punition spirituelle pour tout le clan. Cette confiance reposait sur des idées d'honnêteté et dans la croyance que les femmes étaient plus humbles et plus proches de Dieu.18 Bien que ces systèmes coutumiers se soient affaiblis avec le temps, ils offrent un contraste frappant avec les silences et l'incrédulité qui entourent souvent la violence sexuelle aujourd'hui. Dans de nombreux espaces contemporains, les survivants peinent encore à être crus, faisant de ces anciens cadres une ressource puissante pour imaginer des formes alternatives de justice.
Tradition, religion et le rôle changeant des femmes
L'arrivée du christianisme et de l'islam a apporté des changements significatifs à la manière dont de nombreuses communautés oromo s'engageaient avec des pratiques telles que le sinqee et l'ateete. Bien que ces traditions aient été autrefois reconnues comme des interventions importantes, elles ont progressivement été mises sous la pression des autorités religieuses. Dans certaines régions, l'ateete a été décrit comme un « vestige païen » ou qualifié d'anti-chrétien/islamique, et les femmes qui se rassemblent pour le faire peuvent être perçues comme dépassant les frontières religieuses.19 Parce que ces pratiques se sont développées à une époque où les Oromo suivaient en grande partie les waqaaffennaa, leur système de croyances traditionnel, ils sont souvent considérés comme indissociables de celui-ci. Cela a conduit que certains hésitent à les pratiquer, par crainte que cela ne contredise les nouveaux cadres religieux.
Ces tensions ne concernent pas seulement la croyance, mais la manière dont les religions institutionnalisées ont remodelé les anciennes façons d'organiser la vie sociale. Bien que le système gadaa ait décliné, l'autorité des hommes est restée en grande partie intacte, tandis que la capacité des femmes à s'exprimer et à intervenir en cas de crise via des institutions comme l'ateete et le sinqee s'est de plus en plus limitée.
Bien que ces traditions ne soient plus largement pratiquées, elles n'ont pas totalement disparu. Sur des plateformes comme YouTube, on peut voir des femmes oromo revivre des éléments de sinqee et de ateete à travers des présentations culturelles et des performances.20 Bien que ces derniers ne portent peut-être pas la même autorité qu'auparavant, ils reflètent un effort continu pour honorer et protéger ce qui reste.
Cela résonne profondément en moi. Même si les traditions changent ou perdent leur forme d'origine, elles gardent toujours un sens. Ces pratiques n'étaient pas parfaites, car toutes les femmes n'y avaient pas un accès égal ; Sinqee et Ateete centraient les femmes mariées, soulevant des questions sur la manière dont les femmes non mariées étaient valorisées et sur la manière dont ces systèmes renforçaient les structures patriarcales. Pourtant, elles offrent un point de départ différent, nous montrant que d'autres façons de prendre soin et de résister ont existé, et que s'en souvenir est en soi un acte de maintien de ces possibilités vivantes.
Footnotes
Références
- Sinqee est un bâton en bois symbolisant l'autorité d'une femme mariée, affirmant son droit à être entendue et à vivre avec dignité.
-
L'ateete est un rituel traditionnel de prière et de protestation des femmes Oromo, utilisé pour traiter les préjudices et rétablir l'équilibre social ou spirituel par l'action collective.
-
Marit Østebø, « Wayyuu : Respect et droits des femmes parmi les Arsi-Oromo », dans Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, éd. Svein Ege et al. (Trondheim : NTNU, 2009), 1275–87.
- Østebø, "Wayyuu".
-
Daniel Deressa, Continuité et changements dans le statut des femmes : le cas des Arsii Oromo vivant à proximité de la haute vallée du Wabe (Dodola) (mémoire de master, Université d'Addis-Abeba, 2002).
-
OBN Oromiyaa. Ateetee : Oromummaa fi Safuu Dubartootaa [Ateetee : Oromoness et Éthique des Femmes]. YouTube, 26 février 2023 https://www.youtube.com/watch?v=BbZkspucOKg .
-
Østebø, "Wayyuu".
-
Avant l'introduction du christianisme et de l'islam, la plupart des Oromos suivaient la religion traditionnelle Waaqeffannaa, une croyance en un Dieu omniscient.
- Ibid.
-
L'une des insultes les plus profondément offensantes chez les Arsi-Oromo, faisant référence aux organes sexuels et reproducteurs d'une femme à travers la métaphore des contenants de lait.
- Østebø, "Wayyuu".
- Tailee B. Fiqruu, Reviver des aspects de l'ateetee : un rituel musical féminin Arsi Oromo pour autonomiser les femmes à protéger leurs droits humains et à participer à la vie sociale et religieuse de la société (thèse de doctorat en ministère, 2018), 274.
-
Dilu Shaleka, Tradition, changement et continuité dans l'institution « Yakka » : L'institution réservée aux femmes, l'affaire Sidama (mémoire de licence non publiée, Université d'Addis-Abeba, sans date).
-
Østebø, "Wayyuu".
-
Le qirrin est un tissu traditionnel noué autour du cou d'une femme, exposant les épaules. Comme c'était considéré comme wayyuu, il était interdit aux hommes de le toucher ou de le détacher.
-
Gora est une infraction grave, comme le viol.
-
Østebø, "Wayyuu".
-
Østebø, "Wayyuu".
-
Ibid
- OBN Oromiyaa, Ateetee: Oromummaa fi Safuu Dubartootaa.
Références
- Ayehu, Bacha et Lenin Kuto. 2019. « Les femmes et les hommes dans les proverbes d'Arsi Oromo : une implication pour l'égalité des sexes. »Kafa'ah Journal 9 (1) : 74–86.
- Deressa, Daniel. 2002. Continuité et changements dans le statut des femmes : le cas des Arsii Oromo vivant à proximité de la haute vallée du Wabe (Dodola). Mémoire de master, Université d'Addis-Abeba.
- Fiqruu, Tailee B. 2018. Revivre des aspects d'Ateetee : un rituel musical féminin Arsi Oromo pour permettre aux femmes de protéger leurs droits humains et de participer à la vie sociale et religieuse de la société. Thèse de doctorat en ministère.
- Imana, Gutema. 2022. « Le Muka-Laafaa : l'image des femmes oromo sous le système Gadaa et ses implications pour la paix. »East African Journal of Social Sciences and Humanities 7 (1) : 69–84.
- Jalata, Asafa et Harwood Schaffer. 2013. « La démocratie Oromo, Gadaa/Siqqee et la libération des sujets coloniaux éthiopiens. »AlterNative : Un journal international des peuples autochtones 9 (4) : 277–95.
- Nagara, Ginbar. 2017. « L'expression culturelle du Xunduu (accouplement) dans la connaissance oromo du genre. »Sociologie et anthropologie 5 (1) : 76–84.
- Østebø, Marit. 2009. « Wayyuu : Respect et droits des femmes parmi les Arsi-Oromo. » Dans les Actes de la 16e Conférence internationale d'études éthiopiennes, éditée par Svein Ege, Harald Aspen, Birhanu Teferra et Shiferaw Bekele, 1275–87. Trondheim : NTNU.
- Qashu, Leila. 2019. « Chanter comme justice : Ateetee, un rituel chanté de résolution des conflits chanté par les femmes Arsi Oromo en Éthiopie. »Ethnomusicology 63 (2) : 247–78.
- Regassa, Megersa, Terefe Mitiku et Waktole Hailu. 2019. « Addooyyee : Institution d'amitié autochtone pour filles à Oromoo, Éthiopie. »International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (1) : 307–19.
- Shaleka, Dilu. s.d. Tradition, changement et continuité dans l'institution « Yakka » : l'institution réservée aux femmes, l'affaire Sidama. Mémoire de licence inédit, Université d'Addis-Abeba.
- Tolasa, Megersa Regassa. 2017. « La voix des femmes à travers la poésie orale chez Limmuu Oromo, Éthiopie. »Journal of Ethnic and Cultural Studies 4 (2) : 28–40.

Fayo Said
Fayo Said est une artiste interdisciplinaire et chercheuse artistique originaire d'Amsterdam et d'Oromia (Éthiopie), qui travaille à la croisée de la culture visuelle, des pratiques archivistiques et de la mémoire africaine et afro-diasporique. Son travail consiste principalement à récupérer et à réactiver les archives africaines, en particulier celles d'Oromia, à travers la recherche artistique, la création d'expositions et la production culturelle.